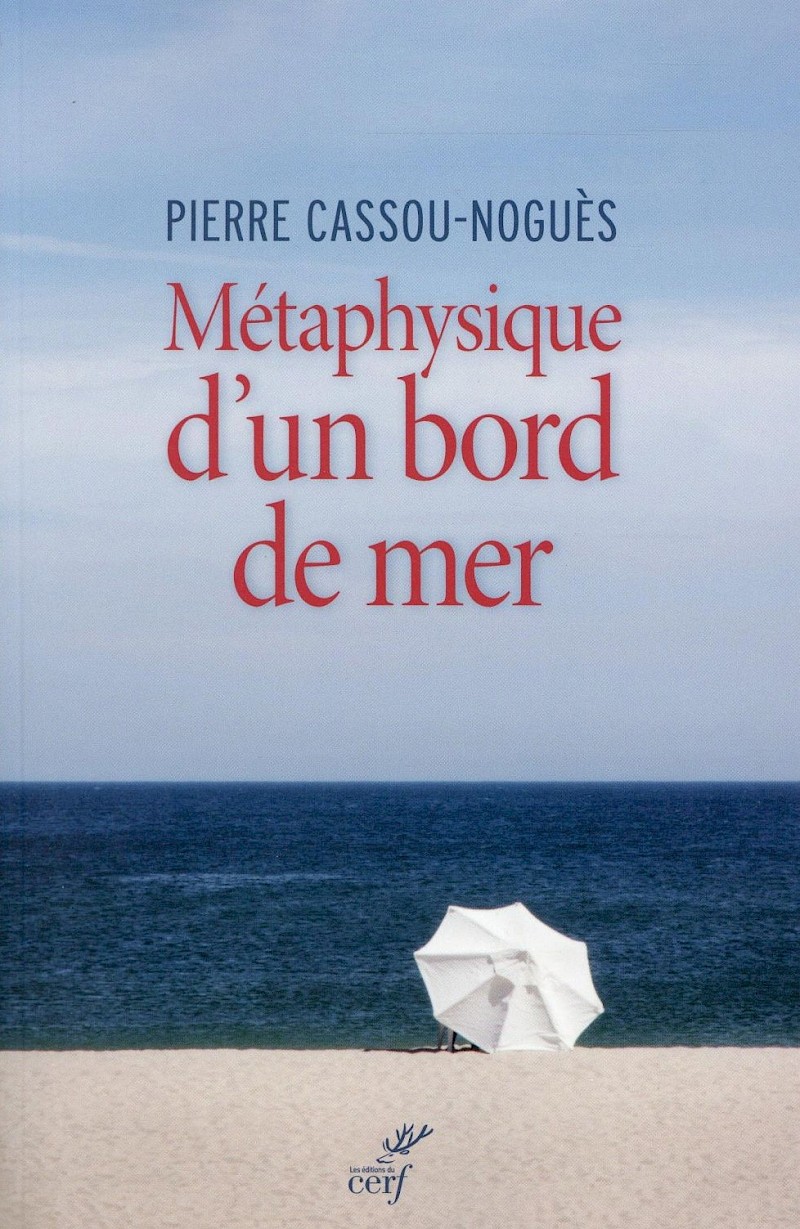La Ville aux deux lumières
Ce texte esquisse une cosmologie imaginaire : une cosmologie, qui analyse notre expérience et en interroge la structure, grâce à un jeu sur des images. Cette cosmologie se développe donc dans des séries de récits. La fiction est le milieu où s’exprime d’abord l’imaginaire, et c’est en s’appuyant sur les images associées aux éléments de notre expérience, en suivant les ressorts propres à ces images, que l’on cherche ici à suivre les fils de notre expérience et à nouer un discours spéculatif.
Extrait
Avant-Propos
Dans De la certitude, Wittgenstein part d’un exemple, donné par Moore, d’une proposition certaine : cette chose sur la table est bien sa main. Wittgenstein vise à montrer que cette proposition et la question de sa certitude sont des problèmes de philosophe, qui ne se posent qu’à partir d’une extension formelle, illicite, de certains jeux de langage. Mais, précisément, pourquoi le philosophe peut-il tomber sur cette question de savoir si, ou de savoir comment il peut affirmer que, cette chose est sa main ? Ce n’est pas par hasard que la question porte sur la main. La main s’y prête particulièrement, cette main qui pianote d’elle-même sur la table sans qu’on le lui demande. On connaît, à commencer par « La main d’écorché » de Maupassant, de multiples histoires de mains qui n’appartiennent plus à personne et ne sont plus alors au sens propre des mains. La question de savoir si cette chose sur la table, d’une forme si étrange, est une main, et ma main, ne se pose que dans des circonstances bien particulières, mais elle est appelée par un imaginaire associé à la main. Wittgenstein ne pourrait pas faire les mêmes analyses en prenant l’exemple, disons, de l’estomac, parce que, précisément, aucun philosophe ne songera à demander comment, ou à affirmer, savoir que son estomac est le sien. Et, posée à propos du cerveau – comment je sais que, dans quelles circonstances je peux demander si, cette sorte de sphère sur mes épaules est bien ma tête et le cerveau qu’elle renferme, le mien – la question conduirait dans des directions différentes. Ainsi, les organes, comme sans doute les éléments bachelardiens, ont des valeurs dans l’imaginaire qui ouvrent des problèmes philosophiques. Autrement dit, il y a, en philosophie, des problèmes qui sont sous-tendus par des contenus imaginaires, des images associées en particulier aux organes.
Le texte qui suit entend utiliser de façon explicite un jeu sur les images pour traiter de questions philosophiques. Il passe donc par la fiction qui est le milieu où se développe l’imaginaire. Il a pour but d’esquisser une cosmologie imaginaire, un repérage des éléments et de la structure de notre expérience, en suivant les ressorts propres aux images qui leur sont associées.
La fiction joue toujours, de façon éventuellement implicite, dans la philosophie. Elle intervient dès la première analyse de l’expérience. La description par laquelle commence le philosophe est déjà une fiction inavouée. Le philosophe évoque une certaine situation : il raconte une scène dans laquelle il se trouve lui-même confronté à certains éléments, un morceau de cire, un papier blanc, qui, comme la main de Moore, ne sont jamais neutres. Par différents moyens, le philosophe appelle d’abord le lecteur à adhérer à ce récit. Ensuite, l’analyse qu’il en propose est déterminée par une constellation de situations possibles qui entourent la situation décrite. C’est que l’analyse philosophique est sous-tendue par une distinction entre des caractères contingents, qui seront omis du compte rendu de l’expérience, et des caractères essentiels sur lesquels, au contraire, le philosophe mettra l’accent. Pour prendre un exemple très général, il est contingent que les yeux avec lesquels je vois soient de telle couleur, et je n’en parlerai pas, mais il est essentiel que ma vision soit située. Je peux imaginer avoir des yeux d’une autre couleur, ou des yeux qui n’auraient pas de couleur et seraient transparents, alors que je ne peux pas imaginer une vision qui n’aurait pas de point de vue, une place dans l’univers visible. Je peux faire varier cette position et cette sorte d’incarnation que le fait d’être situé m’impose, mais cette propriété que la vision est située, une propriété qu’il faudrait préciser et réduire à son véritable noyau, demeure dans toutes les variantes de la vison que je peux imaginer.
Je parle « d’imaginer » mais les bornes de l’imagination sont déterminées par la fiction. Ce que je peux imaginer, en réalité, c’est ce que je peux me raconter ou lire dans une fiction à laquelle j’adhère. Est possible donc une situation que je peux retracer ou que retrace un récit. Si le récit est réussi, si je m’intéresse à ses personnages et suis leurs péripéties, c’est que la situation qui y est mise en place est, en effet, une situation possible. Cette situation, au départ, pouvait me paraître absurde mais mon adhésion au récit signifie que je la reconnais, avec les personnages qu’elle comporte, comme une possibilité. Les personnages peuvent n’être pas possibles au sens des sciences, ni possibles dans le monde que nous connaissons. Ce sont néanmoins des êtres auxquels par mon adhésion à la fiction je prête une vie, une expérience propre, et qui, par conséquent, doivent être pris en compte lorsque, en tant que philosophe, je tente d’analyser l’expérience et d’en dégager les caractères essentiels.
L’analyse de l’expérience, qui est au point de départ de la philosophie, est, pour ainsi dire, une fiction en éventail, une fiction qui se développe dans une constellation d’autres fictions, simplement évoquées. Elle vise à décrire une situation en la confrontant à d’autres possibles, de façon à y distinguer les traits qui feront les concepts du philosophe. Mais la fiction peut également prendre une seconde fonction. C’est que certains concepts de la philosophie n’ont pas d’objets distincts dans l’expérience. Ils renvoient à des termes qui ne sont qu’indiqués, comme des points de fuite dans l’expérience, sans posséder eux-même d’apparaître propre. Il s’agit alors de constituer des images susceptibles de représenter ces éléments. Dans cette seconde fonction, la fiction est comparable la figure géométrique qu’utilise le mathématicien kantien. Le mathématicien, pour Kant, trace des figures – un triangle, la droite par l’un des sommets parallèle au côté opposé – et lit sur cette figure des relations qui ne ressortent pas de la simple analyse des concepts : la somme des angles d’un triangle est égale à un angle plat. De la même façon, l’idée sous-jacente au recours à la fiction est que, pour différentes raisons, certains concepts ne se prêtent pas en eux-mêmes au discours spéculatif : il faut les représenter dans l’imaginaire pour les intégrer dans un discours spéculatif. Il faudrait parler « d’éléments imaginaires », qui ne se présentent pas pour eux-mêmes dans l’expérience et ne peuvent donc être représentés que dans la fiction.
Le sujet, le je, est, en ce sens, un élément imaginaire. Je ne suis jamais donné à moi-même. De l’intérieur, dans la sphère privée pour ainsi dire, des phrases me viennent à l’esprit et se succèdent, différentes sensations se distinguent dans cette région que j’appelle mon corps, le battement de cœur, la respiration, le mal de tête, mais je ne figure pas en personne. C’est de l’extérieur que je me reconnais d’abord, dans des phrases que j’entends, que je lis et qui semblent se rapporter à moi, ou dans des images, comme celle que me renvoie le miroir. Je regarde dans le miroir, je dis « c’est bien moi ». Pourtant, ce n’est jamais tout à fait moi. Parce que cette apparence est contingente, que je pourrais être autre, avec des yeux, une peau d’une autre couleur, parce que j’ai été et serai à nouveau autre, avec un visage plus jeune ou plus vieux et, surtout, parce qu’il semble impossible que moi, qui scrute ce miroir, je ne sois que cela, un corps qu’un chirurgien, ou un accident, peut ouvrir et dans lequel on ne verra alors que de la chair. Du même coup, je me reconnais et je me méconnais dans le miroir. Je n’y apparais pas en propre. Je ne suis nulle part dans le champ de mon expérience : je suis absent.
La seule façon alors de thématiser le je de l’expérience est de le mettre en scène, de constituer des situations qui en révèlent les figures possibles. Et il y a, dans l’histoire de la philosophie, depuis cette confrontation au Malin Génie qu’imagine Descartes dans ses Méditations métaphysiques, de multiples scènes en effet qui visent à faire ressortir la nature propre de ce je.
Mon but en écrivant les pages qui suivent était d’utiliser la fiction pour représenter la subjectivité dans son absence même, cet insaisissabilité par laquelle le je s’indique sans se présenter et exige alors une mise en scène : jouer sur les images pour décrire le rapport même du sujet à ses images. Je me suis livré à des récits qui suivent les transformations d’un narrateur, un jeu de déguisement qui, en son principe, s’inspire du roman de Melville The Confidence-Man, comme de la figure enfantine d’Arsène Lupin. Celle-ci, malgré son évidente naïveté, a quelque parenté avec le personnage de Melville. Du moins, ce qui m’intéressait dans ces deux personnages était la mise en question de leur identité : non seulement l’identité sociale (la profession, le nom) mais bien l’identité personnelle. On ne sait pas, et ces personnages eux-mêmes ne savent parfois plus, dans quelle mesure ils se confondent, ou non, avec les rôles qu’ils interprètent et poursuivent à travers eux une unique existence. L’identité fluctuante, l’absence de terme auquel ces personnages s’identifieraient de façon permanente – Melville et Leblanc disent chacun de leurs personnages qu’à force de prendre des visages différents, ils n’ont plus de visage propre – me semblaient permettre d’illustrer le rapport de reconnaissance-méconnaissance et le caractère insaisissable de ce sujet, disons, absent.
J’ai donc cherché dans la méthode imaginaire une façon de surmonter les difficultés inhérentes à une ontologie centrée sur un sujet insaisissable. S’il est impossible de véritablement définir ce sujet absent, de décrire ce je qui ne se reconnaît qu’en se méconnaissant, il reste à le figurer dans des scènes momentanées pour l’inscrire dans un discours qui détermine sa place et le relief, la géographie pour ainsi dire, du monde qui l’entoure : bref, prendre le sujet absent dans le réseau d’une métaphysique en acceptant que celle-ci passe par l’imaginaire. Il n’y a pas besoin de chercher dans la « grande littérature ». Il suffit d’utiliser ces dispositifs de la « littérature de gare », comme on dit, ces images, ces noms, qui nous sont aussi familiers que la figure du triangle, et jouer sur eux comme le géomètre sur ses figures.
Les premiers problèmes de cette ontologie concernent la relation d’identification du je à ses images, laquelle sera appelée Désir, et sa temporalité. La tradition philosophique renvoie le temps à la conscience et à son flux de vécus. La position d’un sujet sans vécus, qui n’est pas une conscience, reconduit donc inévitablement à la question du temps : la façon dont la temporalité se définit et la multiplicité des temps auxquels le monde ou ce couple d’un monde et d’un sujet absent peut se soumettre.
Différents problèmes sont liés ensuite au caractère imaginaire de cette métaphysique. En particulier, dans la mesure où la métaphysique se fait dans un récit, elle suppose un monde dans lequel le langage a déjà eu lieu. Il est impossible de revenir à une expérience d’avant le langage. Le monde ne se donne que comme corrélat du langage ou dans un parallélisme avec le langage qui interdit même d’interroger la primauté de l’un ou de l’autre. Le monde répond à nos phrases, les vérifie, sans que l’on puisse déterminer si le langage s’est adapté à un monde qui lui préexistait ou si le langage a informé un monde, une expérience pré-linguistique, qui reste alors inaccessible. Il y a du langage, il y a du sensible et l’un se conforme à l’autre. « Ceci est vert » et, en effet, ceci est vert. Or cette adéquation signifie que le ceci porte un être, le vert, qui peut se retrouver dans un cela et, par conséquent, transcende la pure existence du ceci ou du cela. Les existences singulières présentent des êtres qui ne disparaissent pas avec elles. Cette distinction dans l’expérience, de l’être et de l’existence, ou l’événement, conduit au double problème de décrire, d’imaginer dans la fiction, ce qui fait la singularité de l’existence et la généralité de l’être : Pourquoi ou en quoi l’existence est-elle singulière ? Comment penser, où situer l’être qui n’existe pas actuellement ?
Si la méthode imaginaire interdit la régression à une expérience pré-linguistique, elle suppose en revanche une réduction par rapport au sens commun, à « l’esprit du temps », cette ontologie vague qui dépend sans doute des sciences bien qu’elle n’en exprime pas adéquatement les principes. La terre, on le sait, est, pour l’essentiel, une boule de métaux en fusion tourbillonnant dans l’espace. Et, pourtant, on connaît des fictions qui donnent l’image d’une terre plate ou d’une terre creuse, renfermant d’autres mondes ou seulement de beaux paysages. Donc, si la terre sur laquelle nous nous tenons est ronde et pleine, ce n’est pas une propriété essentielle de notre expérience mais un simple accident qu’il faut pouvoir imaginer ne pas être pour découvrir le noyau de notre expérience. Par ailleurs, comme le veut une certaine phénoménologie, le but de la méthode imaginaire reste d’analyser le monde « tel que je le vis ». Or rien n’indique dans mon expérience actuelle que la terre soit ronde, pleine et qu’elle tourne autour du soleil plutôt que l’inverse. En réalité, l’expérience actuelle comporte des traces, ou un halo de représentations qui donnent au monde tel que je le vis sa géographie, et celle-ci ne ressemble pas aux cartes, du reste incomplètes, qui s’esquissent dans le sens commun.
Le récit, le développement de cette cosmologie imaginaire se fait sur deux plans différents. Il s’agit d’abord de décrire et d’analyser notre expérience. C’est la série des « îles ». L’expérience a – je soutiens – une structure d’île, et c’est sur une île déserte qu’elle doit s’analyser. Il y a d’abord la distinction de l’être et de l’existence, la position de nos îles sur une unique terre, le rôle de la lumière qui marque l’existence sans consister en êtres et lui donne alors sa singularité : par là, la lumière inscrit l’existence dans le temps. Il y a ensuite la distinction de l’intérieur et de l’extérieur des corps. L’intérieur du corps, mon corps tel que je l’éprouve de l’intérieur, est une zone d’expérience particulière, peuplée d’existences qui semblent hétérogènes à celles de l’extérieur bien qu’elles se manifestent également dans l’extérieur. Mon cœur que je sens battre de l’intérieur, je peux aussi l’observer de l’extérieur, comme je peux éprouver de l’intérieur telle partie de mon corps que j’ai d’abord isolée par la vue ou le toucher. L’intérieur et l’extérieur, sur l’exemple de mon corps, sont susceptibles de s’échanger, de sorte que l’on peut s’interroger sur l’intérieur des existences extérieures et leur possible regard sur mon corps, symétrique de mon regard sur le leur. Il y a enfin la logique de l’être et son point d’achoppement, le je, qui s’inscrit dans l’être mais en rompt la logique.
La seconde série est celle des « aventures ». Elle consiste en des variations imaginaires autour de problèmes philosophiques, l’être et le temps, le Désir, la vision, le sujet. Il s’agit, pour ainsi dire, d’explorer des situations dans lesquelles ces problèmes se figurent. C’est un jeu plus risqué pour le philosophe, qui doit imaginer : imaginer l’intérieur de la terre, un intérieur que l’on ne voit jamais depuis la surface ; imaginer l’alternance de la lumière et de l’éclairage dans la ville où se joue le Désir ; imaginer ensuite ce point où se concentre l’omni-voyance que semble appeler la lumière ; suivre enfin un cambrioleur qui se cherche un visage.
Si l’on veut jouer le jeu de la fiction, il faut que ces récits, sur ces deux séries, s’inscrivent dans une cosmologie, d’une part, mais, d’une autre part, s’enchaînent dans l’esprit tortueux ou, disons, désynchronisé d’un narrateur. La logique, en quelque sorte, est double puisqu’il s’agit de suivre, à la fois, les raisons de la cosmologie et le fil, la ligne brisée, d’une histoire. C’est sans doute une limite de cette méthode imaginaire, lorsqu’elle détermine, comme c’est le cas ici, le texte entier sans qu’y soit ménagée aucune plage où le philosophe puisse retrouver son langage habituel.
J’ai écrit ce texte au cours de l’été 2005, voilà à peu près trois ans. Il fait suite à une première tentative pour aborder l’imaginaire dans Une histoire de machines, de vampires et fous. Celle-ci avait ouvert pour moi deux problèmes : celui de la portée de la fiction en philosophie et celui des rapports entre les sciences et l’imaginaire. Je me suis attaqué au premier dans cette Ville aux deux lumières, avant de tenter de développer le second dans Les démons de Gödel. Je cherchais des images pour représenter un sujet absent, et un ton, une écriture, pour lier la fiction à la spéculation. C’est un peu pour moi comme une photographie ancienne. Je n’utiliserais pas sans doute aujourd’hui les mêmes images ni la même écriture. La logique double, du moins, est inhérente à la méthode et appelée par le projet même d’une cosmologie imaginaire : une métaphysique qui ne semble pouvoir s’appuyer que sur des images. Il faut alors imaginer des situations, faire varier les structures du je, pour le conduire même sous la terre, hors de la lumière, où il n’y a pas de temps.